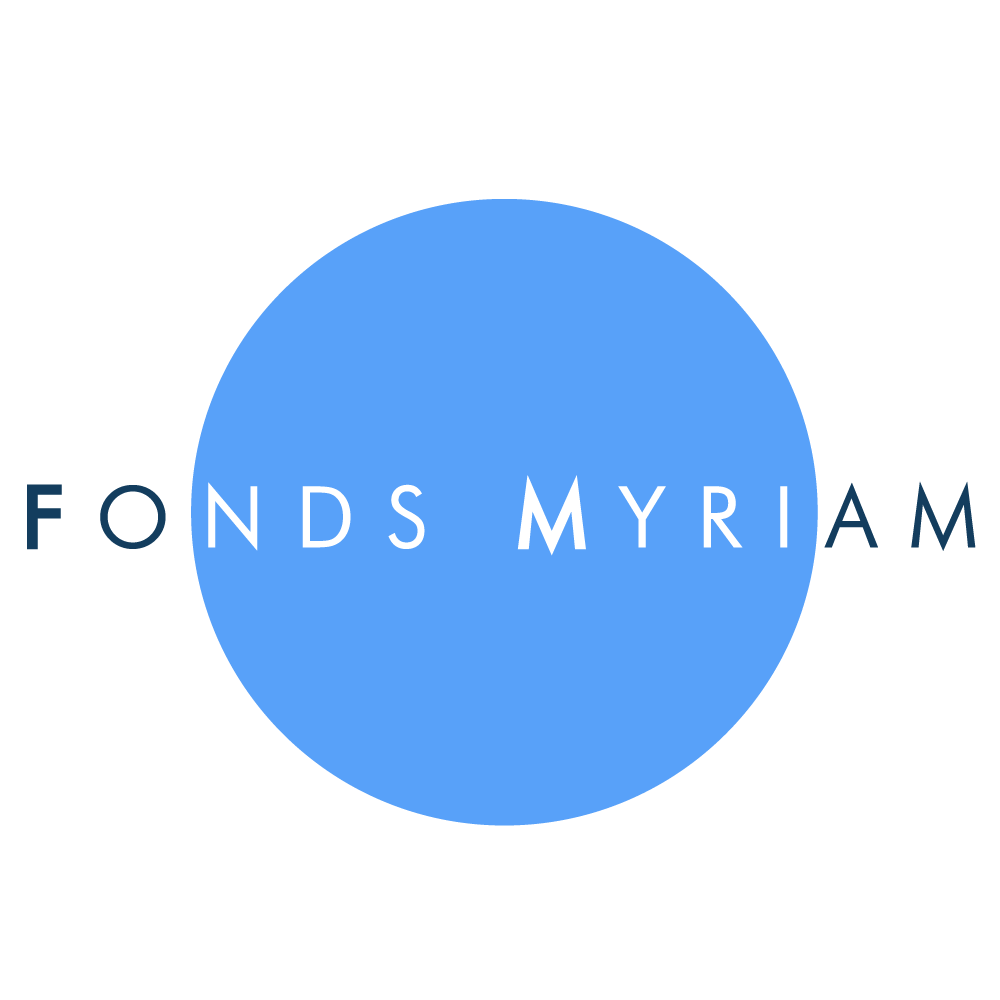Article paru dans l’Arche en mai-juin 2022
Nombreux, même parmi les plus versés dans la tradition juive, ignorent jusqu’à l’existence du Perek Chira : un court recueil rabbinique glorifiant le Créateur pour la splendeur de l’univers, depuis les objets célestes insolites jusqu’aux plus fascinants êtres vivants qui peuplent la terre. Le florilège de versets choisis qui exaltent les merveilles de la Création est précédé d’une forme d’imprimatur de maîtres de l’époque de la Michna, dont le fameux Rabbi Eliezer le grand. Il indique que quiconque s’empare quotidiennement des paroles du présent opuscule, les récite avec cœur et les médite avec soin, est promis à la protection divine et au meilleur accueil dans le monde à venir…
Le recueil est médiéval ; son origine prétendument ancienne a été contestée par des autorités religieuses telles que le Tossafiste Moïse Takou, dès le 13e siècle. Qu’à cela ne tienne, on ne peut qu’apprécier la moisson des sources citées et la subtilité du pied de nez, glissé en introduction, que je ne résiste pas à relayer ici. La légende raconte que le roi David a demandé à Dieu, quelque peu présomptueusement, s’il existait dans le monde une créature qui ait chanté, avec autant de ferveur que lui, la gloire du Créateur. Une grenouille, surprenant la claironnade, fit alors remarquer au Sire que ses coassements n’étaient pas moins puissants et chatoyants, sinon davantage !
À l’heure où le monde prend conscience avec effroi que l’écosystème planétaire est en péril, que des milliers d’espèces disparaissent à jamais, que la fureur productiviste et la soif insatiable de profit conduisent tout droit au désastre, j’aimerais soulever une question quelque peu embarrassante et douloureuse. Et si la tradition juive qui peut se targuer de regorger d’enseignements édifiants sur le soin à porter à la nature, n’empêchait aucunement que nous nous bercions, à l’instar du roi David de la fable, de la même illusion d’autocélébration ? Ou, dit plus crument, si la fixation obsessionnelle qu’a fini par cultiver la Halakha, sur les détails infimes de la pratique rituelle, n’avait pas pour effet paradoxal d’oblitérer les messages latents portés pourtant par ces rites, jusqu’à en étourdir les consciences ?
Intéressons-nous de près à une notion talmudique récurrente : tsaâr baâlé haïm, l’interdit de causer inutilement la souffrance animale. Partons de la considération à laquelle le Pentateuque appelle lorsqu’il interdit de soustraire les œufs ou oisillons du nid au vu de la mère (Deutéronome 22,6-7), d’imposer à un bœuf et un âne de labourer en attelage (idem 22,10) ou encore d’abattre la bête et son petit le même jour (Lévitique 22,28).
Maïmonide (1138-204) explique : « car l’animal éprouverait, dans ce cas, une trop grande douleur. En effet, il n’y a pas, sous ce rapport, de différence entre la souffrance qu’éprouve l’être humain et celle des autres animaux ; car, l’amour et la tendresse d’une mère pour son enfant ne dépendent pas de la raison, mais de la faculté imaginative que la plupart des animaux possèdent autant que l’homme » (Guide 3:48).
Un des grands cabalistes de l’école de Safed, Mochè Cordovéro (1522-1570), lui emboîte le pas : « L’homme ne méprisera aucune créature, car elles ont été conçues par la Sagesse divine. Qu’il n’arrache aucun végétal si ce n’est par nécessité, n’inflige la mort à aucun être vivant, sinon par besoin, et qu’il choisisse alors pour eux une bonne mort, muni d’un couteau soigneusement effilé, agissant avec commisération autant que possible » (Palmier de Débora, III).
La consigne halakhique est, de fait, très claire : L’exécution doit être rapide. Il est interdit, sous peine d’invalidation de la viande, d’interrompre l’incision, d’exercer une pression, une perforation, de déraper du point de section, d’arracher des tissus en raison de l’ébrèchement du couteau ou d’un geste maladroit. (1)
Est-ce à dire que ces précieuses règles pratiques se traduisent en une attention systématique au bien-être animal ? Force est de constater que l’on se tient généralement au périmètre de ce qui a été explicitement édicté, sans en tirer la règle de droit. Prenons l’injonction biblique « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère » (Exode 23,19). Dans l’Antiquité, le seul exégète (dont nous ayons trace) à tenter d’en percer la signification est Philon d’Alexandrie, arguant que « ce qui sert de nourriture à l’être vivant ne doit pas servir à apprêter un être mort. » (2) L’interdit rappelle qu’il n’est pas évident de donner la mort pour se nourrir, de sorte qu’user du lait maternel pour cuisiner la chair trahit une insensibilité qui confine au cynisme.
De son côté, l’interprétation talmudique a tiré du verset l’instauration d’un régime de séparation systématique entre repas lactés et carnés, devenant un marqueur identitaire majeur. Il faut attendre le Moyen Âge pour que de grands exégètes, tel Rabbi Abraham Ibn Ezra, insiste sur l’aspect éducatif du précepte. Toutefois, la leçon édifiante est restée pour ainsi dire anecdotique voire fantomatique, tandis que la logistique de la séparation du lacté et du carné s’est transformée en frénésie, en problème de chimie corpusculaire. La hantise d’un possible « cocktail » des particules est telle que les plus pieux se dotent de frigidaires distincts, voire de cuisines séparées !
Qu’est-il advenu du signal d’alerte, de l’éveil à la condition animale ? On songe au fait que certains groupes piétistes pratiquent le fameux rituel des kapparot qui consiste, la veille de Kippour, à faire tourner un poulet au-dessus de la tête de tout fidèle désireux d’appeler sur lui la compassion divine, en transférant ses péchés. Pour ce faire, les volailles sont entassées, comprimées dans des caisses, certaines blessées durant de longues heures avant d’être égorgées, souvent à la va-vite, pour agoniser ensuite dans des conditions intolérables. Il a toujours existé une opposition religieuse à ce rite expiatoire, pour divers motifs. Celui de la cruauté est invoqué aujourd’hui par des associations, y compris religieuses, mais sans parvenir à en faire cesser la pratique, alors même qu’il existe des rites alternatifs.
Venons-en au débat sur l’abattage rituel, sujet ô combien sensible et politisé. Est-il forcément cruel, comme ses détracteurs le prétendent ou, au contraire, d’une remarquable humanité, comme le clament ses défenseurs, sur la base des consignes évoquées plus haut ? Dans les faits, on sait que des enquêtes ont révélé de graves manquements dans des abattoirs de la filière casher, comme dans celui des Rubashkin Agriprocessors dans l’Iowa, où l’on a pu constater d’insoutenables agonies. Il est vrai que ce type de dérives n’est pas l’apanage des abattoirs juifs et que la maltraitance animale touche tous les secteurs et étapes de l’élevage intensif, y compris le circuit « général » qui désormais requiert l’étourdissement préalable.
Des études vétérinaires il ressort que l’étourdissement a ses ratés (5-7% ; 16% selon le Rabbin Bruno Fiszon) dont on ne saurait ignorer la gravité. Certaines bêtes se réveillent après l’électronarcose (pour les non-bovins) tandis que des bovins restent conscients en raison d’un échec du « tir au matador » (tige perforant la boîte crânienne). Un animal peut alors être charcuté, en pleine conscience et souffrance aigüe. Trop souvent, la recommandation d’une réitération de l’étourdissement en cas d’échec ou de réveil n’est pas respectée en raison des cadences imposées et de l’impossibilité d’un contrôle systématique. Lors de l’abattage rituel, il est vrai que l’étourdissement se produit rapidement à la saignée. Mais pour un nombre non négligeable, ce n’est pas le cas. La perte de conscience est souvent retardée par de faux anévrismes (16 % des cas chez les bovins adultes et 25 % chez les veaux). Chez le bovin, à la différence de l’ovin, il existe une artère vertébrale. Or, la coupe de la trachée artère et de l’œsophage requise par l’abattage rituel s’arrête à la colonne vertébrale. L’irrigation sanguine du cerveau peut durer, selon les cas, de quelques secondes à plusieurs minutes (jusqu’à 11-14 minutes, selon les études), tandis que 10 à 12 % des bovins se réveillent du premier choc d’égorgement !
La possibilité d’étourdir l’animal avant abattage a été étudiée par de grandes figures
rabbiniques dont la plus connue est le Rabbin Yehiel Weinberg (1844-1966)(3) qui a recueilli et discuté plusieurs opinions de maîtres de son temps. Sans entrer dans les détails, il démontre que les réquisits fondamentaux de la loi – à savoir s’assurer que le cœur continuer à pomper le temps d’une bonne évacuation du sang et que l’étourdissement ne dissimule pas des tares de l’animal qui en invalideraient la consommation – peuvent être respectés si l’on met en place certaines procédures. Que ce soit par pur atavisme ou pour de réelles réserves de faisabilité, l’opinion de Weinberg n’a pas été retenue par la majorité des décisionnaires experts.
Au demeurant, il ressort très nettement, se fondant notamment sur l’autorité du célèbre codificateur Mochè Isserles (Yorè déa 23:5) qu’un étourdissement post-jugulatoire, réalisé dans la minute qui suit la saignée, est parfaitement réglementaire et, faut-il le préciser, décisif pour stopper net, le cas échéant, une agonie prolongée. Elle est d’ailleurs prescrite pas des rabbins dans certains pays, en Angleterre, en Afrique du Sud et en Australie. Toutefois, à l’heure d’aujourd’hui, elle n’est pas adoptée dans d’autre pays. L’ingérence des États dans les questions religieuses est considérée par les représentants religieux ou laïques des communautés juives comme atteinte à la liberté religieuse, voire comme malveillance envers le judaïsme. Ils mènent un combat juridique qui, dans de plus en plus de pays européens, finit par produire l’interdiction pure et simple de l’abattage rituel. Il n’est pas exclu que si la solution post-jugulatoire eut été soutenue, il aurait pu en être autrement.
Mais la question qui nous occupe ici est moins pragmatique et, sur un plan religieux, infiniment plus critique. Pourquoi les harmoniques du Perek Chira ne tintent-elles pas à nos oreilles ? Pourquoi la souffrance animale ne s’impose-t-elle pas comme une préoccupation majeure, avec toute la compassion que notre tradition lui accorde ?
Je crains que la réponse soit décevante. Depuis que le monde juif est entré dans l’ère moderne, le judaïsme traditionnel s’est arc-bouté. La peur de se réformer, de se repenser au risque de se déliter. Nous pataugeons dans un pot-pourri où se mêlent des enseignements de la plus haute sensibilité à des considérations ataviques, polémiques et politiques. De temps en temps néanmoins, surgissent des personnalités hors du commun qui bousculent les dénis et le confort de l’autosatisfaction. Je pense, par exemple, au Rav Abraham Isaac Kook (1865-1935) (4) qui estime que le végétarisme formera une phase décisive des temps messianiques ; les offrandes végétales remplaceront les sacrifices, comme l’indique le verset d’Isaïe 11,9 : « plus d’abattage sur Ma montagne sainte. »
Je le confesse : je ne suis ni végétarien, ni militant écologiste. Mais je suis convaincu qu’un monde où l’on dévore bien moins de viande et où l’on se préoccupe bien plus du bien-être des animaux, de la biodiversité et du respect de la nature, est celui auquel nos sources ont rêvé quand elles invitaient l’être humain, depuis l’aube des temps, à entretenir et embellir le jardin dont il a reçu la garde.
Rivon Krygier
Notes:
(1) Cf. Choulhan âroukh, YD, 18, 23 et 24.
(2) De virtutibus 142-4.
(3) Seridé èch, Responsa, Mossad ha-Rav Kook, Jérusalem, 1961,1:1-172.
(4) « La vision végétarienne et pacifiste du judaïsme », dans Olat ha-Raya, Mossad ha-Rav Kook, 1997, I, p. 292.