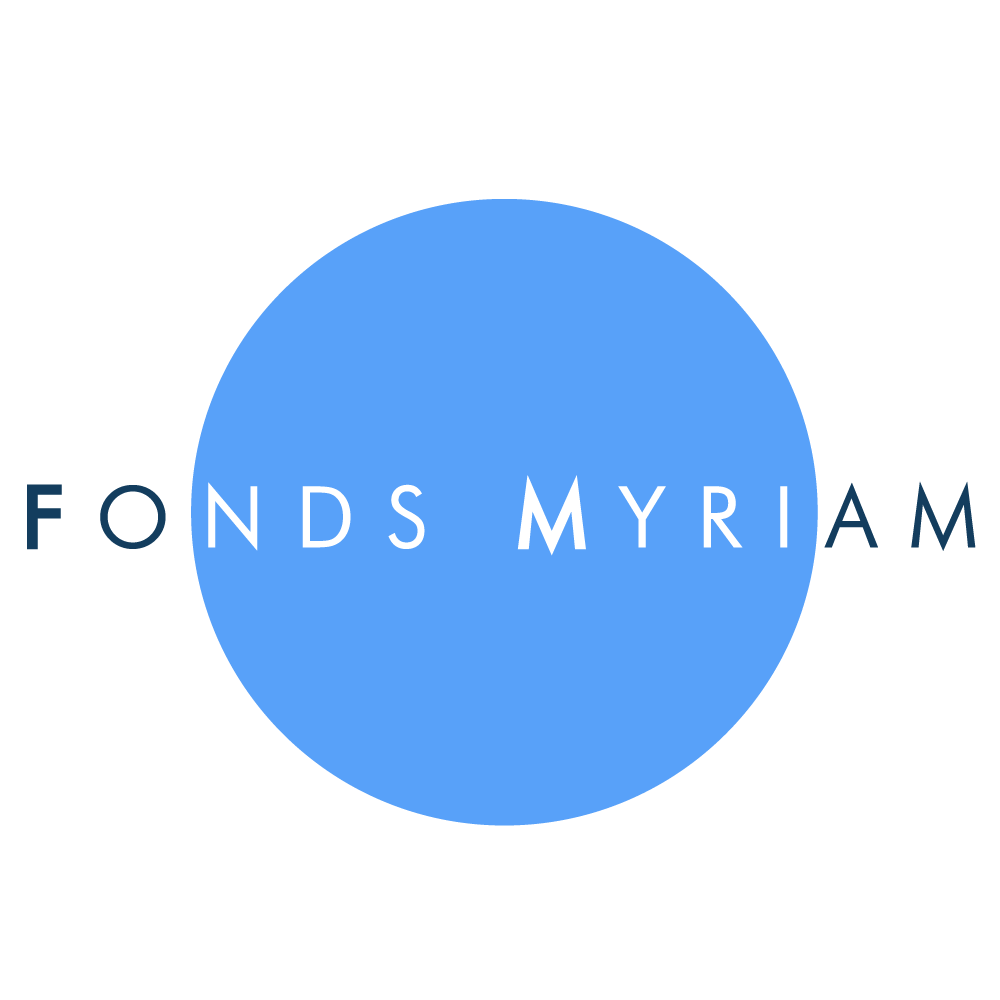Par Michèle Tauber, Roch Ha Chana 5784
Commentaire du poème “Avrhom le patriarche part avec Yitzhhoq pour le ligotage” (voir le document en yiddish et traduction française à la fin de l’article)
Itsik Mangher, naît en 1901 à Tchernowitz, alors capitale multi-ethnique et multi-culturelle de la Bucovine, province située aux marches de l’empire austro-hongrois. Qualifié par Charles Dobzinski, l’un de ses traducteurs en français, comme tout à la fois le François Villon, le Nerval et le Verlaine de la poésie yiddish, il est imprégné de littérature et de chanson yiddish dès son plus jeune âge dans une maison où l’on est tailleur de père en fils.
Le père du poète, Hillel, poète à ses heures, forge d’ailleurs une expression yiddish « sur mesure » dont son fils s’est peut-être inspiré par la suite : pratiquer tout ensemble la littérature et l’étude de la Loi, la Toyrè dans la prononciation ashkénaze, donne : literatoyrè ! En 1935 Mangher invente un nouveau genre poétique, les Chants du Pentateuque, Khumesh lider suivi d’une réécriture de l’histoire biblique d’Esther, Di megile lider, Les chants du rouleau.
L’ouvrage qui paraît en 1951 et qui comprend toute l’œuvre « biblique » de Mangher est intitulé Medresh Itsik / Le midrash d’Itsik. Dans la littérature juive classique, le midrash désigne l’ensemble des commentaires suivis de la Bible. Le midrash poursuit en quelle sorte la vie de la Bible en la renouvelant et en agrémentant le texte de récits forgés au gré des générations sans en modifier le sens originel.
Manguer utilise les éléments qui ont servi de socle à une œuvre à la fois épique : les livres de Samuel et des Rois ; lyrique : l’histoire de Joseph ; ou comique : l’histoire d’Esther. Il se pose en continuateur de la tradition midrashique dans la mesure où le midrash qu’il compose est celui de ses contemporains, éduqués comme lui, dans la même langue, le yiddish. À la manière des auteurs des anciens midrashim, il endosse la responsabilité de son ouvrage en le signant de son nom : Medresh Itsik, et en fait une œuvre artistique.
Le chercheur israélien Dov Sadan compare l’effet produit à celui d’une broderie dont la trame et la chaîne se contredisent l’une l’autre. La trame serait constituée du midrash ancien issu de la tradition qui, tout en dissimulant ses origines par sa forme moderne, fournit une légitimité au texte. La chaîne, représentant le midrash nouveau, distille par la puissance de l’art l’illusion que ce qui apparaît comme un midrash prend réellement sa source dans la Bible. Ainsi, l’aspect irrévérencieux du texte est compensé par la foi dans l’art. Manguer est à la fois l’héritier de ses ancêtres lointains, détenteurs d’une foi pure et candide et le disciple « dévoyé » des poètes yiddish et de leur art.
Ainsi le shtetl imaginaire de Galicie orientale situé à la charnière du XXè siècle devient le décor recomposé pour un nouveau récit de la Aqeda, de la ligature d’Isaac. L’un des textes bibliques les plus célèbres se trouve ainsi concentré dans un poème de neuf quatrains dont les rimes imitent parfaitement les chansons populaires yiddish de l’époque :
Strophes 1 à 3 : français puis yiddish
Le seul véritable paysage pour Mangher est le paysage poétique. C’est ainsi que l’hébreu biblique ba-boqer, « au petit matin », est rendu par le yiddish demerung, une racine germanique qui signifie aussi bien le crépuscule que l’aube, afin de montrer la transition de l’obscurité à la lumière. D’un revers de main, ou plutôt de plume, Mangher métamorphose les deux serviteurs anonymes en Eliezer, le fidèle serviteur auquel Avraham s’adresse en ukrainien : Hayda ! tandis que les ânes orientaux cèdent la place à de simples chevaux. L’étoile bleue – couleur chère à Mangher – qui scintille au-dessus de la maison d’Abraham et Sarah ajoute une touche domestique supplémentaire.
Le paysage des patriarches est à la fois beau et triste et c’est alors qu’intervient une image inexistante dans le texte biblique : Sarah, la mère, est laissée seule près d’une berceau désert. Le voyage du père et du fils a commencé et les dés sont jetés.
Strophes 4 à 7
En l’absence de la mère, c’est au père qu’il revient de calmer les craintes de l’enfant. Le dialogue entre le père et l’enfant ajoute une tension supplémentaire car dès le début on sent que quelque chose n’est pas normal dans la situation évoquée : dans toute berceuse yiddish, c’est la mère qui reste à la maison avec son enfant, alors qu’ici le berceau reste vide et le père emmène l’enfant innocent vers une destinée fatale.
Les deux strophes du dialogue entre le père et l’enfant ne sont pas une simple paraphrase de berceuse : elles sont l’expression d’un désespoir absolu : « Pour une foire, c’en est une », murmure Abraham pour lui-même tandis que le couteau destiné au sacrifice lui brûle la peau. Ce dialogue, central dans le poème est imprégné d’un pressentiment de la mort à venir, exactement comme dans la célèbre ballade de Goethe Erlkönig, Le roi des Aulnes dans laquelle le père conduit lui-même son fils dans les bras de la mort. Si l’on relit la Aqeda à l’aune d’une ballade, le texte apparaît comme le voyage fatidique par excellence dans sa narration juive :
Strophes 8 et 9
Le poème se dirige à présent inexorablement vers son destin. La tristesse affleure, mais on n’y sent pas le sentiment de terreur qu’inspirent le texte biblique ou la ballade de Goethe. Le midrash de Mangher adoucit en quelque sorte la terrible épreuve que Dieu inflige à Abraham ainsi que les allusions surnaturelles effrayantes de la ballade allemande.
Le midrash yiddish ne se conclut pas avec l’apparition d’un envoyé de Dieu arrêtant la main d’Abraham ou avec un roi des Aulnes réclamant son innocente victime, mais avec l’évocation de trois figures bienveillantes : le vieil Abraham, déterminé à exécuter le commandement divin, Eliezer, le loyal serviteur ukrainien, vaguement inquiet et le poète qui a toutes les bonnes raisons de croire que l’histoire se termine bien.
Mais quelle est donc cette « route » qu’Itsik – n’oublions pas que c’est aussi le prénom du poète – doit prendre ? C’est celle où le Tanakh et la vie ne font qu’un, où le paysage de la nature est innervé d’un passé biblique, pas seulement parce que le poète l’écrit mais aussi à cause de la fusion inscrite dans la langue yiddish elle-même. En yiddish, le terme slave pour le mot route est shlyakh, ce qui rime à merveille, et Mangher est le premier à s’en servir, avec Tanakh. C’est avec cette rime que Mangher clôt la première et la dernière partie de son poème. Avec le demerung du début, on a le triptyque parfait du paysage slave, de la Bible et de l’imagination poétique.
Inspiré par Goethe, Mangher a procédé à une nouvelle lecture de la Aqeda. Le titre même laisse présager de la suite : Abraham notre père part (en voyage), comme le fait la quadruple répétition du mot « route ». C’est sur cette route que le petit Itsik est devenu Mangher, le juif fou de Tanakh. Aussi c’est la Bible, et non pas le romantisme allemand, ni le genre de la ballade, qui devient sa muse.
Mais son retour à la Bible s’accompagne d’un double engagement envers la poésie moderne et la continuité juive. « Un judaïsme qui ne remet pas en jeu son propre mythe tel qu’il apparaît dans le texte biblique est voué à l’auto-destruction », écrit Mangher en 1939.
Seul cet engagement, ce désir d’englober son propre contre-destin biblique peut assurer la continuité au le voyage juif.