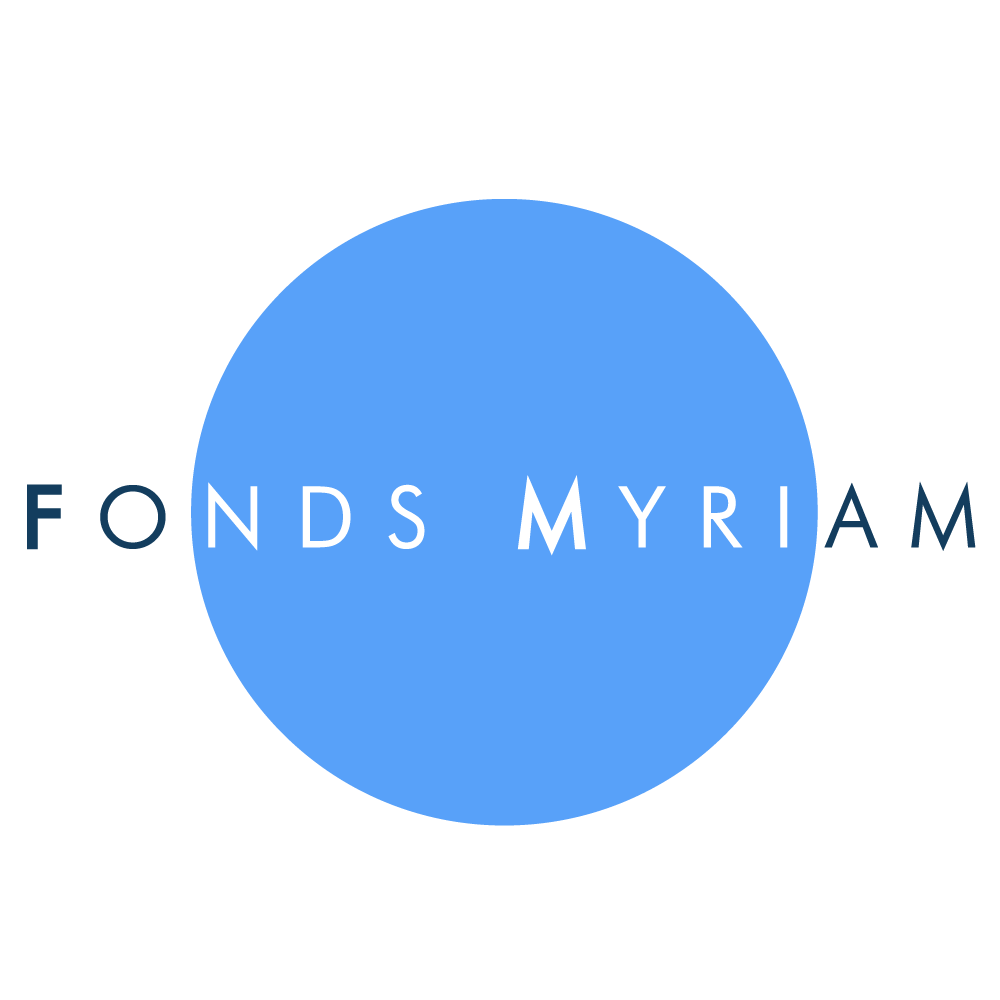La Torah fait apparaître sur scène Yitro au début de notre paracha. Cette arrivée joue comme une respiration, Yitro ramène à Moïse sa femme et ses deux fils: Gershom et Elyezer, l’atmosphère semble maintenant paisible. Moïse accueille alors chaleureusement son beau-père et décide après l’avoir embrassé de lui raconter, ce que celui-ci a pourtant déjà entendu, à savoir l’histoire de leur sortie d’Egypte sous l’aile protectrice de Dieu.
Yitro, présenté à la fois comme “prêtre de Madian” et “beau-père de Moïse”, après ce nouveau récit, va reconnaître le Dieu des bnei IsraëI en lui consacrant un sacrifice. La figure d’Yitro joue ainsi d’emblée un rôle double, celui de personne étrangère au clan (il appartient à Madian) et celui de personne très proche puisqu’il est le beau-père de Moïse et qu’il consacre un sacrifice en l’honneur du dieu des bnei Israël. Il est donc placé à une sorte d’intersection, à la fois à l’intérieur et à la fois à l’extérieur du cercle d’appartenance proche.
A ceci, il faut encore ajouter qu’il se démarque d’Amalek qu’on vient tout juste de quitter, puisque s’il appartient bien comme lui au cercle des étrangers ,il s’en démarque car il est l’étranger ami, alors qu’Amalek est l’étranger ennemi. Et si Yitro succède immédiatement à Amalek dans le cours du récit biblique, ce n’est peut-être pas un hasard. Car, c’est cette position double et cette position en contraste me semble-t-il, qui permettent à Yitro de donner des conseils pertinents à Moïse par rapport à la pratique de la justice, mais aussi de manière plus générale de figurer l’enjeu principal de la paracha, et c’est ce point qui m’intéresse ici, à savoir ce que permet une position d’extériorité, et nous allons voir qu’elle va être déclinée sous différentes formes, et pas seulement sous la figure de Yitro comme je viens de le développer en guise de préambule.
Poursuivons. Le séjour de Yitro touche presque à sa fin, il s’apprête à repartir, lorsqu’au petit matin il voit Moïse affairé à rendre justice. Le peuple le sollicite jusqu’au soir et pour toutes sortes de cas. Yitro observe puis constate que cette tâche est bien trop lourde à porter pour un seul individu. Il en réfère à Moïse et lui donne des conseils organisationnels pour déléguer et pour structurer une sorte de corps exécutif, une institution hiérarchisée capable de rendre la justice, tout du moins en ce qui concerne les affaires de moindre importance. Et ce conseil fait retour ou écho à l’épisode de la guerre contre Amalek lors duquel Moïse n’a pas hésité à se faire aider. D’emblée il a délégué l’exécution sur le champ de bataille à Josué, usé du bâton divin, et sous ses bras d’autres bras encore sont venus pour le supporter. Mais là, Moïse semble avoir oublié cette évidence, à savoir qu’agir seul pour mener un peuple, que ce soit à la guerre ou pour rendre la justice est tâche impossible. Pourquoi ici Moïse semble avoir oublié cette évidence, c’est ce qui m’a paru digne d’enquête. En fait, il me semble que cet oubli, à ce moment précis du Récit, est là pour pointer vers l’élément fondamental déjà mentionné: l’exteriorité.
Cette problématique se décline et je vais maintenant en nommer les différentes formes avant de les repérer dans le récit et d’en dire deux mots.
Sous l’extériorité on retrouvera encore L’intermédiation , et L’abstraction ou plus métaphoriquement la vision, (je pense ici aux 10 paroles: les Asseret hadiberot).
Nous avons vu que l’intermédiation est présente dans la première partie au chapitre 18 (Moïse délègue ses pouvoirs sous le conseil de Yitro), mais elle est encore plus présente dans la seconde partie de la paracha à partir du chapitre 19. C’est d’ailleurs tout le mouvement de la seconde partie lorsque Moïse ne cesse de monter et descendre de la montagne pour transmettre les informations entre Dieu qui se trouve un peu au-dessus du sommet et les Bnei Israël qui se trouvent un peu en retrait par rapport au pied de la montagne.
Car il est difficile de croire que Dieu (suivant les attributs qu’on lui prête) soit incapbale de parler directement aux Bnei Israël. La nécessité de la geste de Moïse pointe donc vers quelque chose.
Observons quelques exemples.
Verset 19:3:
וּמֹשֶׁ֥ה עָלָ֖ה אֶל־הָאֱלֹהִ֑ים וַיִּקְרָ֨א אֵלָ֤יו יְהֹוָה֙ מִן־הָהָ֣ר לֵאמֹ֔ר כֹּ֤ה תֹאמַר֙ לְבֵ֣ית יַעֲקֹ֔ב וְתַגֵּ֖יד לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
Pour Moïse, il monta vers le Seigneur et le Seigneur, l’appelant du haut de la montagne, lui dit: “Adresse ce discours à la maison de Jacob, cette déclaration aux enfants d’Israël:
Verset 19:7
וַיָּבֹ֣א מֹשֶׁ֔ה וַיִּקְרָ֖א לְזִקְנֵ֣י הָעָ֑ם וַיָּ֣שֶׂם לִפְנֵיהֶ֗ם אֵ֚ת כׇּל־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖הוּ יְהֹוָֽה׃
Moïse, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur transmit toutes ces paroles comme le Seigneur le lui avait prescrit
Verset 19:8
וַיַּעֲנ֨וּ כׇל־הָעָ֤ם יַחְדָּו֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ כֹּ֛ל אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר יְהֹוָ֖ה נַעֲשֶׂ֑ה וַיָּ֧שֶׁב מֹשֶׁ֛ה אֶת־דִּבְרֵ֥י הָעָ֖ם אֶל־יְהֹוָֽה׃
Le peuple entier répondit d’une voix unanime: “Tout ce qu’a dit l’Éternel, nous le ferons!” Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur.
Verset 19:10
וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֤ה אֶל־מֹשֶׁה֙ לֵ֣ךְ אֶל־הָעָ֔ם וְקִדַּשְׁתָּ֥ם הַיּ֖וֹם וּמָחָ֑ר וְכִבְּס֖וּ שִׂמְלֹתָֽם׃
Et l’Éternel dit à Moïse: “Rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd’hui et demain et de laver leurs vêtements,
et ainsi de suite…
On voit donc que tout le long de ce chapitre 19, Moïse joue le rôle d’intermédiaire.
Si on entrevoit bien maintenant pourquoi on retrouve le thème de l’extériorité et celui de l’intermédiation au chapitre 18 ainsi qu’au chapitre 19, il faut maintenant s’arrêter sur le dernier chapitre de notre paracha, à savoir le chapitre 20, celui des Asseret hadibérot. Car peut-être que l’enjeu des chapitres 18 et 19 était d’être une propédeutique, une préparation à cette extériorité plus intense que j’ai appelée plus haut vision.
En quoi une vision est une extériorité, me demanderez-vous?
Voyons et reprenons:
Au chapitre 18, on voit Moïse totalement engagé dans la situation, un peu dans le pétrin pourrait-on dire, il règle affaire après affaire mais sans perspective sur ce qu’il fait. Il lui manque ce que j’ai appelé la vision, et c’est en montant sur la montagne qu’il va pouvoir dégager cette perspective abstraite. En effet, entre le chap 18 et 20 voilà ce qu’il se passe, Moïse monte.
Mais pourquoi monte-t-il? Car Dieu l’appelle et le fait être le dépositaire de la vision, de sa parole (on sait que dans la tradition juive on “voit des voix”) car la Justice doit être plus que la somme des cas que Moïse réglait jusqu’à présent de manière procédurale.
Pour que Moïse puisse se dégager d’une pure casuistique, il lui a donc fallu être aidé des conseils d’Yitro qui lui a soufflé l’idée d’intermédiation, et que Dieu le convoque sur la montagne pour lui donner une vision de la justice qui aille au-delà de l’arrangement casuistique.
Cette prise de distance coûte probablement quelque chose à Moïse, en tout cas c’est comme cela que je l’imagine. Affectivement, il doit abandonner les êtres dont il a la charge. Il ne sera plus en contact direct avec eux. Mais il va gagner une autre perspective. La possibilité de se tourner vers une source ou une abstraction. C’est le troisième moment de notre paracha lorsque Moïse est monté et que les 10 paroles sont proférées. Elles ne peuvent devenir phénomène audible que parce que Moïse a atteint ce que la philosophe Iris Murdoch appelle dans son livre la souveraineté du bien “une source distante de perfection” et maintenant il accède et avec lui le peuple, à un méta énoncé. Une structure principielle. Et ceci n’est possible que parce que Moïse s’est dégagé de la situation et parce qu’il a fourni des efforts, on voit cela dans la deuxième partie de la parasha au chapitre 19 avec toutes ses montées-descentes.
Mais pourquoi ces allers-retours insistants et presque cartoonesques? On peut aisément imaginer un récit plus économe. Pour moi, cette répétition ajoute encore une chose: L’hésitation. Moise hésite à se détacher des êtres humains et des cas concrets. Il comprend l’enjeu de la vision, d’une vision de la justice en tant qu’elle repose sur des principes fondamentaux et non des arrangements au cas par cas, mais il sait qu’il perd dans le même temps la finesse et la possible toute proche attention aux êtres et à leurs besoins et il est tiraillé en son for intérieur. C’est pourquoi il préfère continuer à monter et descendre comme pour tenir les deux places à la fois. Comme si c’était possible.
Nous voyons donc que Moïse au cours des trois parties expérimente trois positions, celle de proximité au tout début, puis celle d’intermédiaire qui fait des allers-retours incessants au milieu, puis celle qui le place à distance, et tout près de la finalité de la vision. Ce qu’on remarque c’est que chacune de ces positions coûte quelque chose à Moïse. Tout près, il s’épuise. A faire des allers-retours il s’épuise, et tout en haut il est seul. Cette solitude, il la goûtera d’ailleurs amèrement à la toute fin de son parcours, lorsque Dieu lui intimera l’ordre d’aller mourir sur la montagne lui refusant l’accès à la terre promise. Ce refus comme pour dire deux choses par rapport à notre problématique de l’extériorité : tout d’abord que la recherche du bien ou de la justice n’offre et ne doit offrir aucune récompense, elle ne doit pas faire retour sur-soi mais rester extérieure à l’égo, ou dit autrement : l’objectif ne peut se retourner sous l’ombre d’une récompense égotique, le geste est gratuit. Si Moïse accomplit tout cela c’est pour la chose en elle-même et non pour en tirer une récompense, c’est ce que Dieu semble lui signifier. La deuxième, c’est qu’en plus de l’absence de rétribution, il y a celle, tout aussi cruelle, de consolation. L’absence de consolation. Car si on ne peut pas changer ce fait, celui de n’être pas récompensé, au moins aurait-on pu trouver un peu de chaleur dans des bras aimants pour adoucir ce dur constat. Or, il n’en est rien. Ni récompense ni consolation.
Moise dans la troisième partie de la paracha quitte le monde humain pour remplir sa tâche, pour s’approcher de la vision. Il sera pour cela non récompensé et non consolé, et pire, on sait qu’il devra par lui suite en agissant en tant qu’intermédiaire entre Dieu et les Bnei Israël, essuyer les critiques et les haines qui viennent d’en bas, mais aussi les remontrances et les colères qui viennent d’en-haut.
Cependant ni l’en-haut, ni l’en-bas encore une fois, ne viendront pour le consoler du poids de sa charge. Cette position est tragique, le pouvoir et la responsabilité acquises à bon escient se paient d’une solitude abyssale, en quelque sorte d’une extériorité existentielle. Moïse doit être plus que humble, il doit procéder à la Hitbatlout chel anokhiout: à l’annulation du moi. Lui qui est né dans un fleuve, élément qui symbolise le débordement, il doit opérer au cours de sa vie le plus fort rétrécissement qui soit, à savoir le tsimtsoum de son être. Et s’évider de lui-même, s’abstraire à lui-même, et s’abstraire de ses proches.
S’il ne nous est pas demandé à nous simples “Ploni et plonit” une telle abnégation, il n’en demeure pas moins que nous devons garder à l’esprit cette image, cette vision. Car peut-être qu’elle peut nous aider à faire communauté du mieux possible, et à faire humanité du mieux possible. Alors sachons cultiver une goutte d’extériorité et une goutte d’attention.