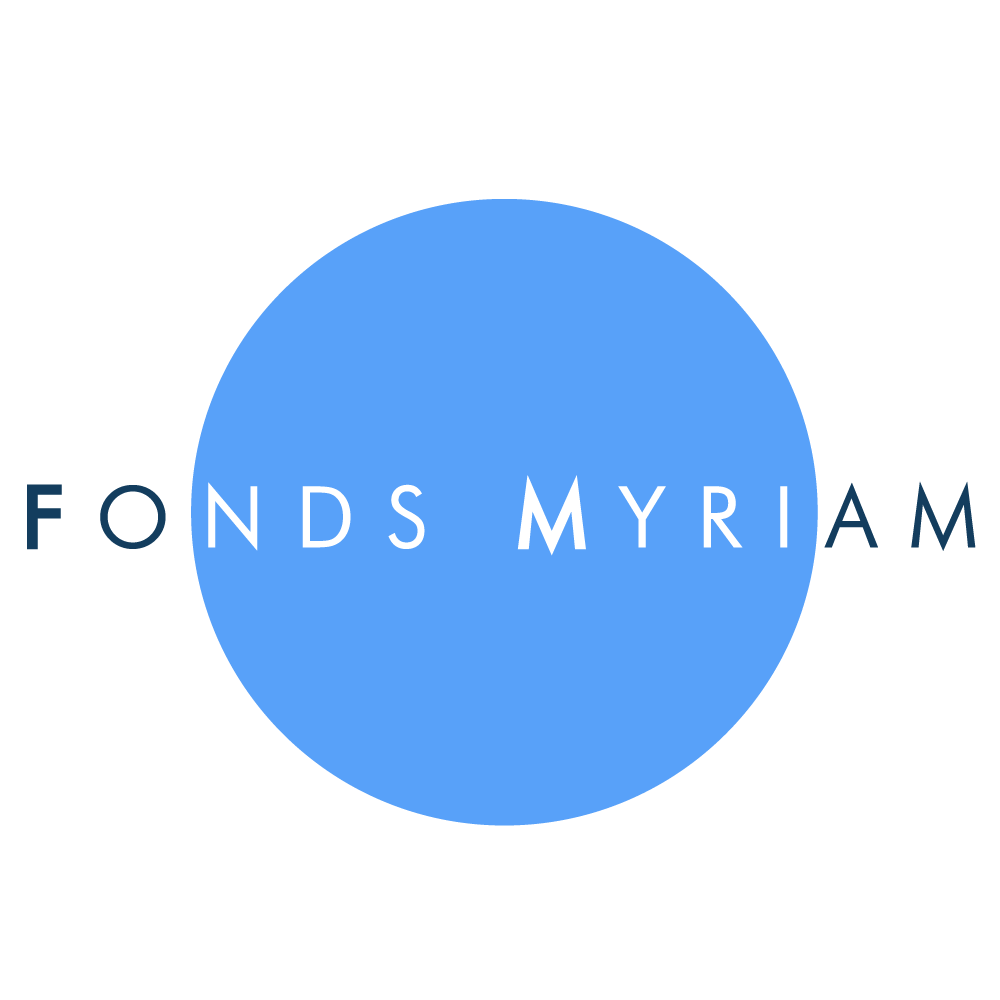Par le rabbin Josh Weiner
Une question poignante m’a été posée la semaine dernière. Une personne observant le chabbat, avec ses obligations, ses restrictions, ses joies et ses difficultés, m’a demandé si elle et sa famille pouvaient exceptionnellement allumer la télé pour regarder la libération des quatre otages à Gaza. Elle voulait ressentir une partie des émotions puissantes avec l’ensemble du peuple juif vivant l’expérience tant attendue à ce moment-là.
Mon premier réflexe a été d’éviter la question : tous les problèmes n’ont pas de réponse halakhique ! Bien sûr, j’aurais pu parler de la puissance du maintien du rythme de l’observance du chabbat. Dans un monde où nous sommes inondés de nouvelles, d’images, de faits, de chiffres et de visages, peut-être que le fait d’être temporairement déconnecté a encore son propre pouvoir. Peut-être qu’éviter la théâtralité manipulatrice du Hamas, connaître les grandes lignes de la libération des otages sans avoir besoin d’absorber tous les détails, prier pour le bien-être des otages et espérer la libération de tous ceux qui restent sans exception, peut-être que cela suffit pour une expérience de chabbat connectée au reste du peuple. Et il pourrait y avoir des solutions techniques aussi, bien sûr, avec des minuteries etc.
Mais j’ai aussi ressenti quelque chose à la base de la question, qui pressentait qu’il s’agissait d’un moment historique et qu’il méritait donc d’être traité comme exceptionnel. Ce moment, ou peut-être toute la série d’événements depuis octobre 2023, est ce que les philosophes appellent simplement un Événement, quelque chose qui rompt un certain ensemble de présomptions et en crée d’autres afin de rendre compte du fait qu’il s’est produit. Surtout, un Événement nous pousse à prendre conscience de ce qui se passe et à construire une histoire à raconter à ce sujet.
Cela nous amène à la paracha de cette semaine, qui raconte l’histoire de l’Événement ultime du peuple juif : la libération de l’esclavage en Égypte. Si nous regardons attentivement, nous constatons que le processus de narration commence en même temps que les événements eux-mêmes. Déjà au milieu du récit des plaies, après les sept premières plaies et avant les trois dernières, le besoin de raconter une histoire est exprimé. La paracha commence avec Dieu qui dit à Moïse ce qui suit :
וַיֹּ֤אמֶר יְ—הֹוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה בֹּ֖א אֶל־פַּרְעֹ֑ה כִּֽי־אֲנִ֞י הִכְבַּ֤דְתִּי אֶת־לִבּוֹ֙ וְאֶת־לֵ֣ב עֲבָדָ֔יו לְמַ֗עַן שִׁתִ֛י אֹתֹתַ֥י אֵ֖לֶּה בְּקִרְבּֽוֹ׃ וּלְמַ֡עַן תְּסַפֵּר֩ בְּאׇזְנֵ֨י בִנְךָ֜ וּבֶן־בִּנְךָ֗ אֵ֣ת אֲשֶׁ֤ר הִתְעַלַּ֙לְתִּי֙ בְּמִצְרַ֔יִם וְאֶת־אֹתֹתַ֖י אֲשֶׁר־שַׂ֣מְתִּי בָ֑ם וִֽידַעְתֶּ֖ם כִּי־אֲנִ֥י יְ—הֹוָֽה׃
“Rends-toi chez Pharaon ; car moi même j’ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs, à dessein d’opérer tous ces prodiges autour de lui et afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j’ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j’ai opérées contre eux ; vous reconnaissez ainsi que je suis l’Éternel. “ (Exode 10:1-2)
Laissez-moi mettre de côté pour l’instant les questions sur l’endurcissement du cœur et le libre arbitre que Ruben a déjà résolues lors de sa Bar Mitsva jeudi — nous y reviendrons dans un instant. Mais avant même cela : le sens premier de ces versets est que les événements dramatiques de la sortie d’Égypte ne se produisent pas dans le but d’être libres. Tous ces événements sont plutôt faits pour qu’il y ait une histoire à raconter, comme si c’était l’objectif le plus important de tous. Et si l’on considère attentivement les versets, il se passe quelque chose d’encore plus remarquable. Dieu dit à Moïse que les miracles des dix plaies ont lieu « afin que tu les racontes à ton enfant et à l’enfant de ton enfant ». Toi, au singulier. Toi, Moïse, tu raconteras ces histoires à tes enfants et à tes petits-enfants. Et si l’on considère la suite du récit dans la Torah, il est vrai que parmi tout le peuple d’Israël qui a vécu l’exode d’Égypte, ce sont seulement la femme et les deux fils de Moïse qui viennent le rejoindre par la suite. Ils sont donc les premiers à découvrir la sortie d’Égypte sous forme de récit, et non comme un souvenir personnel. [J’ai entendu dire que le deuxième Belzer Rebbe, R. Yehoshua Roke’ah, avait également remarqué cela, mais je n’ai pas trouvé ses écrits sur le sujet. Le Talmud parle aussi de certaines traditions que Moïse a transmises spécifiquement à ses petits-enfants].
On fait parfois la distinction entre deux mitsvot différentes dans la Torah : raconter l’histoire de la sortie d’Égypte (sippour yetsiat mitsraïm) et se souvenir de l’histoire de la sortie d’Égypte (zekhirat yetsiat mitsraïm). Le fait de raconter, sippour, se fait une fois par an à Pessah, tandis que le fait de se souvenir, zekhira, peut se produire tous les jours, lors de la récitation du Chema ou du kiddouch par exemple. Le Rav Haïm Soloveitchik de Brisk identifie trois différences principales entre les deux commandements. Sippour se présente sous la forme de questions et de réponses verbales, comme « Ma nichtana » lors du seder, tandis que Zekhira peut être un processus interne consistant à se rappeler ce qui s’est passé. Sippour exige de raconter l’histoire en détail, avec un début, un milieu et une fin, alors que la Zekhira peut être accomplie en mentionnant brièvement l’événement. Enfin, Sippour impose d’expliquer les raisons des pratiques que nous faisons pour marquer ce qui s’est passé, comme manger de la matsa, alors que Zekhira n’a pas une telle exigence. [Shiurei Avi Mori (Vol. 2, pg. 153) ] Plus fondamentalement, et au-delà de toutes les différences qui les séparent, les deux processus se renforcent l’un l’autre : le récit annuel de l’histoire et sa mention quotidienne l’enfoncent profondément dans notre conscience, de sorte qu’elle devient une partie de ce que nous sommes.
Ce jeudi matin, Ruben a abordé les questions fondamentales du libre arbitre et de la connaissance de Dieu, ainsi que de la responsabilité de Pharaon pour ses actes et pour ses punitions. Ses réflexions étaient exceptionnelles et, en plus de citer de nombreux commentaires, il a également apporté des points de vue scientifiques. J’ai été particulièrement intéressé par l’idée que la répétition est un moyen de renforcer les voies neuronales qui deviennent difficiles ou impossibles à briser. De cette façon, nous pouvons comprendre ce qui arrivait à Pharaon : après avoir lui-même refusé de libérer le peuple d’Israël cinq fois de suite et « endurci son cœur », nous lisons que Dieu a endurci son cœur. En fait, c’est son cerveau qui s’était fossilisé de manière à ne plus pouvoir changer. Ce qui avait commencé comme un choix est devenu son essence même ; il est devenu lâche et obstiné.
La construction de l’histoire de la sortie d’Égypte et le commandement de la répéter tout au long de notre vie, de la transmettre à nos descendants et de vivre selon les valeurs qu’elle représente, est donc un parallèle positif à ce que Pharaon s’infligeait à lui-même. Pharaon répétait « non » jusqu’à ce que cela devienne une partie de ce qu’il était. Les Juifs répètent « nous sommes destinés à la liberté et à la responsabilité » jusqu’à ce que nous ne puissions pas nous imaginer autrement, peu importe qui tente de nous opprimer. Nous choisissons de faire d’une idée une partie intégrante de notre personne jusqu’à ce qu’elle ne soit plus un choix. La Bar Mitsva célèbre également ce choix de ne plus choisir. Jusqu’à présent, tu as reçu des histoires. Désormais, tu prends sur toi l’obligation de te considérer comme impliqué par ces histoires et de les raconter, à ta façon bien sûr, à d’autres. Que nous puissions choisir avec sagesse les histoires que nous racontons, en connaissant le pouvoir qu’elles ont.
Chabbat chalom !